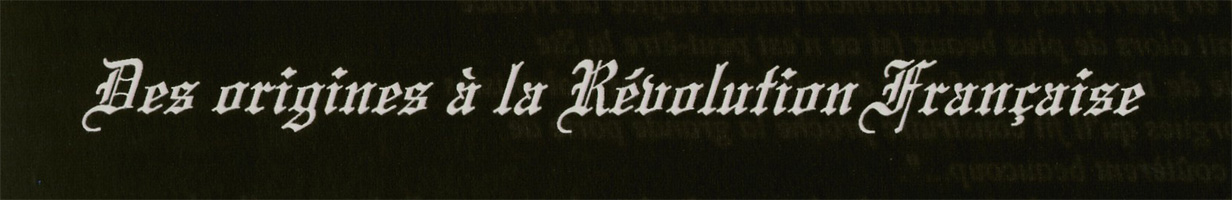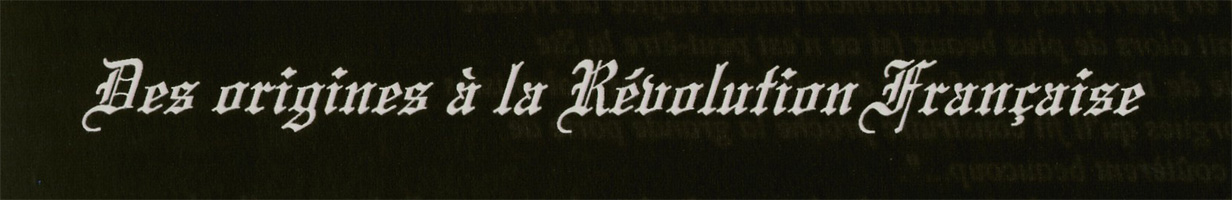|
|
Portaits imaginaires
DENYS L'AUXERROIS
... Le récit qui va suivre est une légende étrange et assez précise de
retour d'un âge d'or, ou doré par la poésie (...), qui survint dans une vieille cité de la France médiévale.
De la ville française proprement dite, dans laquelle les vestiges des siècles
successifs, et quelques notes joyeuses du présent, se fondent harmonieusement en une beauté spécifique --une
beauté cisalpine et septentrionale, bien distincte pourtant du massif pittoresque germanique d'Ulm, de
Fribourg et d'Augsbourg, et dont Turner a trouvé l'idéal dans certaines de ses études de France, car une
conjonction heureuse de rivière et de ville fait l'essentiel de sa physionomie-- la ville d'Auxerre
constitue peut-être l'exemple le plus parfait à proposer au voyageur moderne. Elle est certainement, au
point de vue du pittoresque, la plus expressive d'un groupe de trois villes remarquables de la région, --
Auxerre, Sens et Troyes,-- dont chacune se presse, comme de propos délibéré, autour de la masse cnetrale
d'une immense cathédrale grise.
... Auxerre ! une pente légère sur la route sinueuse, et voici devant
vous la plus jolie ville de france ; le large cadre des vignes, semées dans le lointain de blanches
chaumières qui incitent à la marche, monte en pente douce vers l'horizon ; au-dessous c'est la boucle molle
la rivière avec tous les détails de ses quais, et dominant la foule des maisons, plus abruptes, plus
irrégulières qu'aucune autre église de France, les vastes masses à tuiles rousses de Saint-Germain, de
Saint-Pierre et de la cathédrale Saint-Etienne. Sujet tout fait pour cet artiste rare qu'est un bon peintre
de monuments, s'il comprend la valeur des masses et des lignes, des masses énormes et des lignes délicates.
... Pour bien remplir les heures d'une de ces après-midi où la pluie,
tôt venue, interdisait toute promenade, je me dirigeai vers la boutique d'un vieux brocanteur. Ce n'était
pas de ces exhibitions monotones copiées sur celles des magasins parisiens, d'un fond de boutique que l'on
a vu partout, mais une collection choisie de curiosités véritables. On reconnaissait la tradition de la
province en maintes reliques de la vie domestique du siècle précédent, et en nombreux bijoux des époques
antérieures, tirés des vieilles églises et des maisons religieuses du voisinage.
Il y avait, entre autres, un important et éclatant fragment de vitrail, qui pouvait provenir de la
cathédrale même. D'une rare qualité de couleur et de dessin, il représentait un personnage difficile à
rapporter à aucun type connu, et faisait manifestement partie d'une série. A mes instantes questions sur ce
qu'il avait pu advenir du reste, le vieillard répondit que l'on n'en savait rien, mais ajouta que le curé
d'un village voisin possédait toute une suite de tapisseries évidemment destinées à une église, et qui
représentait l'ensemble du sujet dont le vitrail en question ne formait qu'un détail.
Le lendemain, je me rendis aupresbytère, petite bâtisse gothique toute proche
de l'église du village, et partie sans doute d'un ancien chateau... Le prêtre mit beaucoup de courtoisie
à me montrer ses tapisseries dont certaines, pendues au mur du parloir et de l'escalier, servaient de fond aux
autres curiosités de sa collection. Incontestablement, vitrail et tapisseries représentaient le même sujet.
On retrouvait, sur les unes et sur l'autre, les mêmes instruments de musique, pipeaux, cymbales et trompettes
en forme de roseaux. Et il y était question d'un orgue en construction, instrument de tout point semblable,
mais sur une plus grande échelle, à celui qui se trouvait dans la bibliothèque du vieux prêtre, et
demeurait maintenant presque sans voix, tandis que sur certains des panneaux tissés, les auditeurs
semblaient enchantés par la musique de l'instrument qu'ils acclamaient même d'enthousiasme. Et partout,
entre les complexités délicates de toutes ces scènes, semblait régner une sorte de fole véhémence, danses
vertigineuses, bondissements de faunes, et éternels festons de vigne... C'était le constructeur de l'orgue
lui-même, jeune homme blond et fleuri que l'on voyait tantôt presque nu parmi les pampres, tantôt emmitouflé
de fourrures, pour se protéger du froid, tantôt en robe de moine, mais qui laissait toujours une impression de
réalisme frappant et en rapport singulier avec le caractère des rues d'Auxerre. De qui s'agissait-il ?
C'était evidemment, malgré sa grâce et la richesse du décor, un être douloureux et tourmenté. Avec toute la
beauté classique d'un dieu païen, il avait souffert des tortures sans doute inconnues à ces dieux... C'est
avec cette idée, en recourant aux notes trouvées dans l'intéressante bibliothèque du prêtre, touchant
l'histoire des travaux accomplis dans la cathédrale à l'époque de son achèvement, et à la suite d'études
répétées des vieilles tapisseries, que je sentis la vérité se faire jour dans mon esprit.
Vers le milieu du XIIIème siècle, tout le gros oeuvre de la cathédrale
Saint-Etienne était achevé ; il ne restait plus à élever que la grande tour, et à pousser tout ce travail
final de décoration qu'une seule génération ne pensait pas devoir mener à bien. Et cependant, certaines
circonstances, un peu confuses encore déterminèrent un achèvement rapide, et quasi instantané des
travaux, qui n'en gardèrent pas moins un caractère remarquable de richesse et de grâce. De cette décoration
une bonne partie fut détruite, ou transférée en d'autres lieux ; mais il en subsiste des vestiges
somptueux sous forme de vitraux et surtout de sculptures très délicates des portails de l'ouest, taillées
dans la belle pierre dure de Tonnerre (Yonne NdA)dont le temps n'a fait que dorer la surface...
... Une étrange coutume se perpétuait à Auxerre. Le dimanche de Pâques,
les chanoines jouaient solennellement à la balle en plein centre de la vaste église. (NdA. Légère erreur,
c'est au niveau de la première travée, là où était le labyrinthe -depuis disparu- proche des grandes portes
que se situait la fête, d'après les textes d'époque) Après vêpres, au lieu de reconduire l'évêque à son
palais, ils se rendaient en cortège dans la nef, au milieu de l'affluence des fidèles qui se rangaient de
part et d'autre pour les regarder. Retroussant à demi leurs soutanes, les clercs attendaient leur tour en
silence ; le chef des enfants de choeur lançait la balle en l'air, aussi haut qu'il le pouvait, sous la
voûte de la nef principale, et ses camarades s'eforçaient de la rattraper ; celui qui y avait réussi la
relançait de la main ou du pied vers l'un des chantres majestueux, des chapelains ou des chanoines même,
qui s'adonnaient au jeu avec tout le décorum d'une cérémonie ecclésiastique. C'est au moment même où les
prêtres se relançaient la balle avec tant de solennité que Denys --Denys l'Auxerre comme on l'appela plus
tard-- fit sa première apparition. Bondissant au milieu des enfants intimidés, il fit de la cérémonie une
aprtie véritable. Les enfants se mirent à jouer comme des enfants, les hommes comme des fous, et tous avec
un bel enthousiasme qui se communiqua bientôt aux clercs, puis aux spectateurs mêmes. Le vieux doyen du
chapitre, protonotaire de sa Sainteté releva un peu sa soutane et, s'avançant avec une vivacité stupéfiante
comme s'il eut été soudain allégé du poids de ses quantre vingts ans, lança du pied la balle au vénérable
prêcheur capitulaire, qui sut se montrer à la hauteur de la situation. Après quoi les laïques, incapables
de demeurer plus longtemps inactifs, se mêlèrent au jeu avec des cris de joie plus ou moins étouffés, et
prolongèrent la partie jusqu'à ce que la pénombre de l'église empêchât de dsitinguer la balle.
... On éprouvait, par-dessus tout autre, à lépoque, le désir de créer
les instruments d'une musique sacrée plus ample et plus variée que l'on en avait pu faire encore, d'une
musique qui put traduire toute l'expansion des âmes dorénavant muries. Auxerre, dès cette époque, était,
comme elle le fut plus tard, renommée pour sa musique liturgique. Ce fut Denys à qui revint, en définitive,
l'idée de combiner en une masse musicale élargie tous les instruments alors en usage. Comme l'ancien dieu
du vin, il avait aimé et pratiqué la musique des pipeaux sous toutes leurs formes. Ici encore se
manifestèrent trois époques ou "modes" de son influence : d'abord, c'est le mode simple et pastoral, la note
familière du chalumeau, pareille au souffle de la brise sur les campagnes lointaines ; puis le fracas
frénétique et sauvage, effroi des gens rassis, qui avait affolé les coeurs sensibles. Enfin, il
s'efforça de faire concourir toutes ces formes à de plus douces fins, et la construction du premier orgue
devint le véritable livre de sa vie, et traduisit toute sa nature dans ses délices et ses détresses. En de
longues journées heureuse de vent et de soleil, le frère apparemment simple d'esprit chercha et trouva sur
les berges de la rivière les espèces de roseaux nécessaires. Sous sa direction, les charpentiers
construisent les gros tuyaux de bois pour déchaîner les tonnerres, cependant que de petites flûtes de
carton imitaient le son de la vois humaine et répondaient aux notes victorieuses des longues trompettes
de métal. Parfois, aux gens qui entendaient nuit après nuit ces sons discordants, tout ce bruit faisait
l'effet d'un travail de dément, mais de temps en temps c'étaient les bribes d'une musique incontestablement
nouvelle qui les arrachaient à leur sommeil et les émerveillaient. Le roseau, triomphait, à tous ses degrés
de puissance, assoupli, unifié, assagi. Mais sur les panneaux décorés de l'orgue, Appolon, lyre en main, et
maître des cordes, semblait écouter sans bienveillance la musique des roseaux et sentir renaître la jalousie
qui avait si cruellement fait meurtrir Marsyas.
... Cependant les vents de son orgue étaient prêts à souffler, mais ce n'est
pas sans peine qu'il obtint du chapitre l'autorisation d'éprouver leur puissance à l'occasion d'une grande
cérémonie. Voici en quelles circonstances. On attendait à Auxerre un hôte de marque. En récompense de
quelques service rendu au chapitre, le sire de Chastellux se paraît héréditairement de la dignité de chanoine
de l'église. Au jour de sa réception il se présentait à l'entrée du choeur, revêtu, par-dessus son attirail
guerrier, du surplis et de l'amict. Le vieux comte de Chstellux étant récemment décédé, son héritier avait
annoncé sa visite, pour se prévaloi, selon la coutume, de son privilège ecclésiastique. Il y avait eu
longtemps rivalité entre les maisons d'Auxerre et de Chastellux, mais, en cette occurence, une offre de
réconciliation sous la forme d'une demande de la main de dame Ariane.
Le beau jeune homme se présenta et, dûment équipé, fut, aux vêpres, installé
dans sa stalle, en présence de l'évêque. C'est alors qu'avec des sentiments de délices variés, la foule
entendit pour la première fois la musique de l'orgue rouler sur sa tête. Mais l'exécutant et constructeur
de l'instrument passa inaperçu, l'ancien favori ne retrouva point sa popularité. La cérémonie fut suivie
d'une fête civile par laquelle Auxerre accueillait son futur maître.
... Ainsi s'expliquait la figure du vitrail et Denys me paraissait avoir
réellement vécu à Auxerre. Par des jours d'une atmosphère spéciale où les traces du moyen âge ressortent
comme les vieilles marques sur les pierres lavées par la pluie, je me figurais avoir réellement vu le
personnage douloureux, avoir rencontré dans les rues Denys l'Auxerrois.
W.P. 1887
|
|