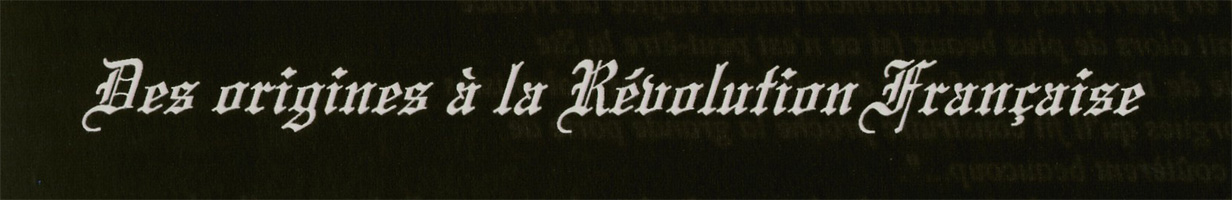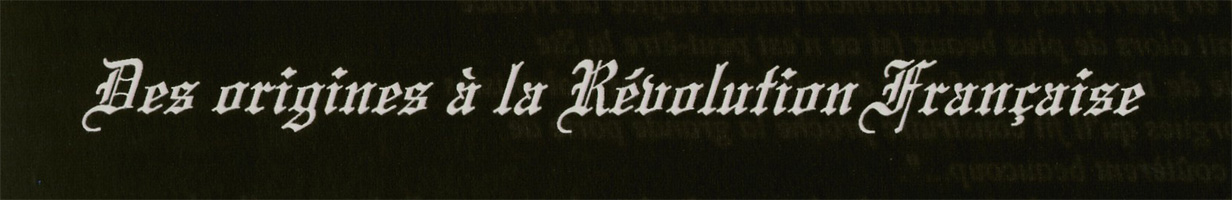|
|
LIMINAIRE
Vous pouvez trouver sur cette page quelques explications sur la monnaie de l'époque Louis XIII - Louis XIV.
L'Evêque d'Auxerre et le Chapitre cathédral.
L'Organiste. - De tous les instruments dont les effets s'harmonisent
le mieux avec la musique religieuse, l'orgue occupe assurément le premier rang. Aucun autre ne saurait lui disputer
la prééminence. Réunion de presque tous les instruments, qui composent un orchestre, l'orgue séduit l'oreille
par la richesse de ses accords, la variété de ses modulations, qui se déroulent sous les voütes immenses des
vastes édifices pour lesquels il semble avoir été spécialement créé. S'il accompagne le chant, les services qu'il
rend ne sont pas moins grands. Il se marie si bien avec la voix du chanteur et lui apporte un concours si puissant
que l'artiste, se sentant bien soutenu, peut développer tous ses moyens et donner pleinement la mesure de son talent.
D'origine fort ancienne il n'apparaît pas cependant que la cathédrale en ait
possédé un avant le XVIème siècle ; du moins les titres n'en font pas mention à cette époque.
Le 31 mai 1529 est établi un procès-verbal de réquisition par Mr l'évêque d'Auxerre
au Chapitre pour la pose d'un orgue qu'il a fait faire et qu'il veut placer contre le pilier où est l'image de
St Sébastien. Le chapitre refusa.
Dans cette chronologie historique il faut faire état d'un personnage qui n'a rien à
voir avec les orgues, mais dont la tombe en précise l'emplacement :
"Louis BRIDE prit possession le 19 avril 1538 (de la cure de Mézilles (Yonne)), en vertu de permutation avec le
précédent (curé), et mourut en 1539 au mois de décembre. Il fut inhumé sous le Portail de la Visitation qu'il avait
fait faire : c'est celui où est aujourd'hui représenté la Résurrection proche les orgues."
...
L'orgue contenait 14 jeux, et le buffet était travaillé avec une exquise délicatesse.
Lors de la prise de la ville, les Huguenots s'emparèrent des tuyaux, mais n'endommagèrent pas le buffet, qui aurait
pu recevoir de nouveaux jeux et servir comme par le passé.
Il n'en fut pas ainsi.
AUXERRE ET SA CATHEDRALE AU XVIème SIECLE
... Le jour de Pâques, après midi, la cathédrale contenait à grand-peine la foule accourue. Tout le clergé de la ville,
le gouverneur, les magistrats se pressaient au premier rang.
A l'heure fixée, les chanoines faisaient leur entrée solennelle et se groupaient
au bas de la nef, tout près du grand portail, à l'endroit où l'on voyait jadis, inscrit dans le dallage, un
labyrinthe circulaire.
Là, l'un d'eux, le dernier nommé, se présentait porteur d'une grosse balle que les
anciens documents appellent "pila" ou "pilota" et la remettait au doyen ou, à son défaut, au membre le plus
digne de la compagnie. Celui-ci mettait alors sur sa tête la poche de son aumusse, appuyait avec son bras
gauche la pelote contre sa poitrine, tendait la main à droite à l'un de ses collègues, et bientôt le Chapitre
entier formait cercle autour du labyrinthe et commençait la plus curieuse des danses. On chantait le Victimae
Paschali laudes et l'orgue, installé à cette époque dans la première travée du bas-côté nord,
accompagnait l'extraordinaire ronde, marquait le mouvement, entraînait tous les chanoines, les vieux aussi bien
que les jeunes, dans un branle incontestablement pittoresque... le Chapitre continuait autour du doyen sa ronde
innocente, entraîné qu'il était par les accents étourdissants de l'orgue tout proche et par la voix infatigable des
chantres et des enfants d'aube.
Chanoine FOURREY
LA PRISE D'AUXERRE (1567)
AMYOT, LA LIGUE
... L'orgue qui comprenait 7000 tuyaux... devient la proie des soldats, qui détruisent
ce qu'ils ne peuvent emporter.
LEBEUF
Histoire de la prise d'Auxerre
Extrait d'une lettre de M. le procureur général à M. l'évêque d'Auxerre, François de
Dinteville II du nom, au sujet de la cérémonie de la Pelote.
|
Monseigneur, quand je vous trouvai à Saint-Saphorin, je n'eus le loisir de vous tenir le propos que le roy,
étant à Lyon, pendant son diner, avoit tenu de la cérémonie qui se fait en votre église le jour de Pâques
qu'on appelle la Pelote d'Aucerre, et ce en la présence de messieurs les cardinaux de Lorraine et du Bellay,
M. de Soissons et autres. C'est qu'aprez avoir entendu en quoi consistoit ladite cérémonie, il dit qu'elle
étoit bonne et louable, et qu'on ne la devait oster, ni abolir sans grande cause, mais s'il y avoit de
l'abus ou
|
difformité, que l'on devoit oster ladite difformité, et observer ce que jusques-là avoit été honnêtement fait. Et autant
en dit le roy des Festages d'Angers. Ce que j'ai récité à M. le premier président, et à M. Disques,
rapporteur du procez, qui sera cause... que sans grand cause et considération on ne abolira ladite
Pelote, mais plutot d'entériner requête qui fut faite d'envoyer ledit seigneur Disques et un commissaire
de ladite cour voir ce qui en fera lorsqu'on fera ladite cérémonie, pour en faire procez-verbal et rapport
à ladite cour.
|
Signé : Thibaud, procureur général
De Paris, le 5 may
(Tiré de l'original.)
...
... On s'étonne..., que la colossale statue de Saint Christophe, qui se dressait jadis
dans la cathédrale, à l'entrée de la nef, ait été épargnée...
Le saint -véritablement monstrueux- mesurait près de dix mètres. Il avait pour
baton un tronc d'arbre, "garni de noeuds, de la grosseur d'une feuillette et d'une longueur de 32 pieds".
Commencée en 1540 par le chanoine Jehan OLIVIER, curé de Champlemy, la statue fut continuée par les soins de son neveu,
Jacques de BALLEUR, et achevée au temps de François II de DINTEVILLE dix ans plus tard.
Cette statue vénérée des auxerrois, qui ne manquaient pas en outre de se prévaloir
de ses proportions étonnantes, était célèbre dans toute la région et fit pendant plus de deux siècles l'admiration
des nouveaux venus et des étrangers : "Il y a dans la cathédrale, écrit RETIF de La BRETONNE, un
Saint Christophe qui a pour bâton un chêne qui a bien cinquante pieds de haut et qui ne lui vient qu'au menton !..."
Mais certains s'indignaient de ces mêmes proportions, comme d'une offense à
l'esthétique et au bon goût ; le culte superticieux, dont la statue était l'objet, inquiétait en outre quelques
chanoines scrupuleux. Le comte de CAYLUS, neveu de l'évêque, avait voué au géant une haine mortelle : "Il faut,
disait-il, que j'aime la paix autant que je l'aime pour n'avoir pas fait entrer la nuit ou de grand matin
des ouvriers dans l'église pour abattre cette statue monstrueuse ! ". Saint Christophe, toutefois, survécut de
quelques années à son détracteur.
Mais, en 1768, il était condamné sans appel et malgré les protestations des habitants
et de certains ecclésiastiques, des équipes d'ouvriers s'attelaient au colosse et parvenaient à le renverser. C'était
le 28 avril.
NOSTRADAMUS, dit-on, avait prédit l'événement. On trouve en tout cas, dans les
Centuries, cet étrange quatrain :
84.
Vn grand d'Auxerre mourra bien misérable
Chassé de ceux qui sous luy ont esté ;
Serré de chaines après d'un rude cable,
En l'an que Mars, Venus et Sol mis en esté.
|
3ème ANNEE
|
JANVIER-FEVRIER 1932
|
LA CATHEDRALE
Bulletin Paroissial de Saint Etienne d'Auxerre
paraissant tous les deux mois
Abonnement ordinaire : SIX francsADY PER 118/1 pp 19 à 22
Nostradamus, Saint Christophe
et les chanoines de la Cathédrale
Ainsi parla Nostradamus :
Un grand d'Auxerre mourra bien misérable,
Chassé de ceux qui sous lui ont été,
Serré de chaînes, après d'un rude cable,
En l'an que Mars, Vénus et Sol ont été
1
Voilà, n'est-il pas vrai, une prophétie singulière, et qui me fait amèrement
regretter mon ignorance en matière d'astronomie. Je vous indiquerai, en effet, sur le champ, lecteurs amis,
l'année qui vit la conjonction de Mars, de Vénus et du soleil, et, l'histoire en mains, je chercherais avec
vous quel grand d'Auxerre eut l'infortune d'être repoussé, martyrisé par les siens à cette date fatale...
A dire vrai, pourtant, je ne crois guère aux prophéties de Nostradamus... Il
m'importe donc assez peu que ce devin fameux ait vu juste ou se soit trompé dans le cas qui nous occupe...
Et, de confiance, il me plaît d'admettre que l'année fixée pour la réalisation de la prédiction soit 1768...
Cela m'arrange fort bien, car 1768 vit la chute lamentable (C'est son point de vue. NdA) d'un "grand
d'Auxerre"... J'ignore s'il fut "serré de chaînes, après d'un rude cable", mais je sais qu'il fut vraiment
"chassé de ceux qui sous lui ont été"... Ce "grand d'Auxerre" n'était autre que le gigantesque Saint Christophe
qui se dressait autrefois à l'intérieur de la Cathédrale, près de la porte d'entrée, et qu'une décision du
chapitre condamna à mort... Lorsque je dis de ce Saint Christophe qu'il était un "grand d'Auxerre", je n'exagère
pas. Essayez d'imaginer quelles étaient les invraisemblables proportions de sa statue.
"Elle avoit, dit un mémoire historique daté du 1er juillet 1768, 29
pieds de haut depuis la tête jusqu'aux pieds, quoiqu'elle fut penchée en devant, suivant l'attitude d'un homme
qui porte un fardeau très pesant. La largeur du corps d'une épaule à l'autre étoit de 16 pieds. Chaque oeil
avoit un pied de fente, d'un coin à l'autre, et neuf pouces d'ouverture du haut en bas. La bouche avoit 15 pouces
et demi ; chaque bras 6 pieds 2 pouces, chaque main 3 pieds 2 pouces. Les jambes avoient 6 pieds de long ; la
grosseur du mollet 6 pieds 2 pouces de circonférence. L'enfant Jésus étoit sur ses épaules, de façon que les
jambes étoient passées autour du cou et les pieds portoient sur la poitrine ; c'est ce qu'on appelle vulgairement
à califourchon. Il tenoit d'une main une boule, qui représentoit le monde. De la tête aux reins il avoit 10 pieds
et demi. Chaque pied avoit 2 pieds 8 pouces de long et un pied de large. Le bâton que Saint Christophe portoit
de la main droite étoit un tronc d'arbre garni de noeuds qui avoit environ 32 pieds de hauteur. Dessous les pieds
et aux environs étoient sculptées des ondes remplies d'animaux aquatiques. Le piedestal, sur lequel le tout
étoit posé, avoit 11 pieds de haut. L'intérieur étoit massif et garni de grosses pierres de taille. L'extérieur
étoit aussi de pierres sculptées, excepté le bâton qui étoit de bois recouvert de plâtre. A côté de Saint
Christophe étoit la figure d'un ermite prosterné ou à peu près. Au-dessous du colosse étoit représenté en bas-relief
le martyre de Saint Christophe. On y voyait le Saint attaché à un poteau et des soldats qui lui lançoient des
flèches".
Si une semblable statue ne réalisait pas toutes les conditions requises pour
constituer une oeuvre d'art, on conviendra du moins qu'elle n'était pas banale, et qu'elle ne pouvait manquer
d'attirer les regards des fidèles à leur entrée dans la cathédrale...
Attirer les regards, c'était le rôle essentiel de ce colosse. On connait en effet
la dévotion fameuse à Saint Christophe et la conviction aujourd'hui encore assez répandue - Attention à la
superstition ! notai-je en passant - que, si l'on regarde, le matin, l'image du glorieux Porte-Christ, on ne
mourra point dans la journée.
Glorieux Saint Christophe, le matin te voyant,
Sans crainte d'aucun mal, on se couche en riant.
Quand du grand Saint Christophe on a vu le portrait,
Vois d'abord Saint Christophe et marche en sûreté !
De la mort, ce jour-là, on ne craint point le trait.
Autrefois Notre-Dame de Paris, avait une énorme statue du bon géant, et à
Strasbourg on admirait un colosse d'une hauteur de 36 pieds ; lorsqu'on voulut l'enlever de la Cathédrale pour
le transporter à l'hôpital de la ville, on dut, pour la sortie, lui couper les pieds et les mains. La même
Cathédrale garde encore, dans une verrière du transept sud, une image étonnante du Saint. Celui-ci n'a pas
moins de huit mètres de haut. C'est la plus grande figure sur vitrail que l'on connaisse.
La Cathédrale d'Auxerre fut dotée de son Saint Christophe au XVIème siècle par un
chanoine, le curé de Champlemi, nommé Jean Olivier. Ce digne homme ne vit d'ailleurs pas lui-même l'oeuvre
achevée. Il mourut, laissant à son neveu Jacques le Bazilleur le soin d'achever sa pieuse entreprise.
Je relève l'inscription qui fut gravée sur le socle de la statue :
Maître Jean Olivier, natif de Bar-sur-Seine,
Curé de Champlemi et de céans chanoine,
L'an 1540, pour rendre à Dieu hommage,
Du martyr Saint Christophe fit faire cette image ;
Ung an après mourut, cy gist en sépulture.
Vous qui par cy passez, voyant sa pourtraicture,
Priez Dieu pour son âme et pour vous on priera,
Car comme vous ferez, pour vous certes on fera.
Si j'en crois le mémoire historique où je trouve ces détails, les chanoines
n'étaient guère ravis du travail des sculpteurs. "On trouve dans les registres du chapitre que cet ouvrage
n'estoit pas entièrement fini le 28 avril 1551 ; que le chapitre étoit fort mécontent de la grossièreté de la
sculpture et vouloit qu'on employât des sculpteurs plus habiles".
Lebeuf, de son côté note ceci dans la "Prise d'Auxerre par les Huguenots" :
La statue de ce Saint taillée dans le temps que les prétendus Réformez
commençaient à crier contre le culte des images. Il auroit été à souhaiter, dans des temps si délicats, que
l'idée de Jean Olivier chanoine qui fit commencer l'ouvrage eut été plus régulière ou au moins qu'il n'eut pas eu
le dessein de la faire paroitre deux fois plus gros que celui de Notre-Dame de Paris. Edme Baleure, chanoine la fit
achever après la mort de M. Olivier en conséquence des menaces que le chapitre lui fit de le détruire s'il le
laissoit si longtemps imparfait ! Cet ouvrage, exposé à la vue de tous ceux qui entrent, n'a encore pu être
goûté d'aucunes personnes éclairées. Au reste, il est bon qu'on sache que le chapitre empêcha soigneusement
qu'on ne toucha au pilier".2
Chose singulière, cette extraordinaire statue, qui, semble-t-il, eût dû plus
qu'aucune autre exciter la fureur des Huguenots, lors des ravages de 1567, échappa au massacre général.
"Le dégât qui paroit fait à l'image de Notre Seigneur, représenté sur les épaules de Saint Christophe, est
selon les apparences un effet du tonnerre et non de la main des Huguenots", a soin de nous faire remarquer
l'abbé Lebeuf.2
Saint Christophe cependant ne devait pas durer de longs siècles. De divers côtés
on le critiquait. On trouvait qu'il nuisait à la beauté de la Cathédrale. L'auteur du mémoire déjà cité écrit :
"Pinganial de la Force dans son Etat de la France, le grand dictionnaire géographique de la Martinière et
autres, qui se sont copiés, disent à l'article d'Auxerre que l'église Cathédrale n'a rien d'extraordinaire, mais
que le palais épiscopal est un des plus beaux qu'il y ait en France. C'est dans le fait tout le contraire. Le
célèbre Cervandoni regardait cette église comme la plus belle et la plus régulière qu'il eut vue après Saint
Pierre de Rome. M. le comte de Caylus, si connu pour la supériorité de ses talents, par son goût exquis pour les
beaux arts, ce grand connoisseur disoit de même que cette église est l'une des plus belles du royaume par la
délicatesse et la régularité de son architecture. Elle a 50 toises de long sur 30 de large, elle est bien
proportionnée, bien éclairée et bien pavée.
Feu M. de Caylus, notre responsable prélât pensoit comme son neveu, mais plus il
admiroit la beauté de son église, plus il étoit peiné de voir un colosse qui en défiguroit l'entrée. Ceux qui
ont vécu avec lui se souviennent lui avoir entendu dire plus d'une fois : Il faut que j'aime la paix autant
que je l'aime pour n'avoir pas fait entrer ou la nuit ou de grand matin, des ouvriers dans l'église pour
l'abattre".
Ce que l'évêque n'osait pas faire, les chanoines de la cathédrale le firent le
28 avril 1768.
Depuis 30 ans, continue l'auteur du mémoire, les chanoines de la cathédrale
ont employé plus de cent mille livres aux décorations de leur église. Au mois d'avril dernier, ils faisoient
démolir les murs qui masquoient le sanctuaire, et les deux portes collatérales, chargées de statues et bas
reliefs en pierre, ouvrages postiches et sur-ajoutés à la noble simplicité de l'église, qui seront remplacées
par de belles grilles de fer. Ces démolitions étoient presque achevées, les chanoines ont cru devoir profiter de
l'occasion pour débarrasser l'église d'un colosse monstrueux, difforme et mutilé, qui la déshonoroit ; d'autant
plus qu'il ne servoit qu'à amuser le peuple, qu'une vaine curiosité y attiroit, sans aucun sentiment de piété
et de religion. C'est ainsi que la démolition du colosse fut conclue dans un chapitre assemblé, à la presque
unanimité, sans aucune réclamation. On y employa sur-le-champ les ouvriers qui étoient dans l'église avec
leurs échelles et leurs outils".
Triste fin en vérité !...
Un grand d'Auxerre mourra bien misérable
avait dit Nostradamus...
Je noterai, en terminant, que malgré les terribles chanoines du XVIIIème siècle, Saint
Christophe a trouvé le moyen de demeurer auxerrois.
Nous le reconnaissons dans l'un des huit compartiments de la claire-voie placée
sous le concert céleste de la grande rosace.
Mieux que cela ! Par une singulière ironie du sort, il se trouve que toute la
série des statues qui peuplaient jadis les innombrables niches de la façade et de la tour une seule a échappé à la
tourmente des siècles, c'est, au-dessus du portail de Notre-Dame, celle de notre glorieux Porte-Christ.
R. F.
1
Cent.4, num.84
2
Prise d'Auxerre p.136
|
|